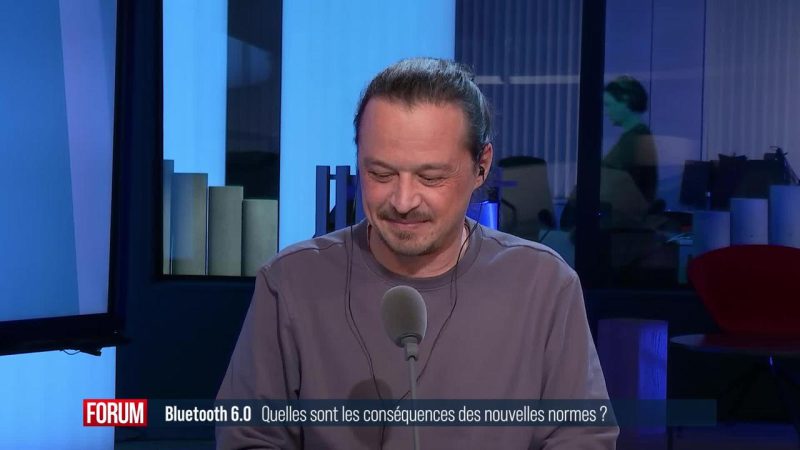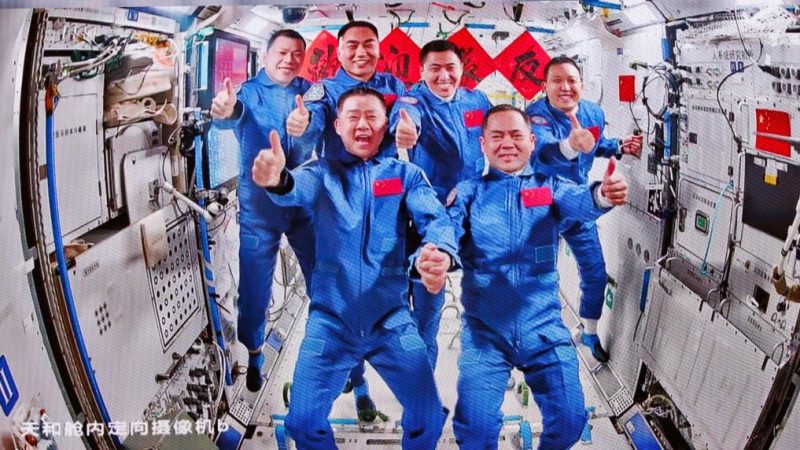Désextinction : limites d’une science émergente et enjeux économiques

La désextinction, une science en devenir
Rouvrir le chapitre des espèces disparues n’est pas seulement une idée de fiction selon certains chercheurs, qui explorent ce que l’on appelle la désextinction. Cette discipline, encore émergente, suscite à la fois des promesses et des interrogations sur son utilité, ses limites et les risques potentiels associés à la remise en vie d’animaux éteints, tout en interrogeant les priorités de conservation actuelles.
Des repères clairs pour un débat
Selon Lionel Cavin, co-auteur et directeur du Muséum d’histoire naturelle de Genève, ce champ n’est pas aussi extraordinaire qu’on pourrait l’imaginer; il rappelle que les scénarios de désextinction ne se produiraient pas comme dans les films. Certains présentent même cette démarche comme une réponse à l’extinction, ce qui a motivé l’écriture de l’ouvrage.
Le cas du loup sinistre et les limites de l’approche génétique
Nadir Alvarez, co-auteur et directeur du Muséum cantonal des sciences naturelles du canton de Vaud, met en garde contre les promesses formulées par certains groupes privés: il ne s’agit pas de « désextinction » au sens strict, mais de modifications génétiques sur des animaux existants pour obtenir des ressemblances avec des espèces disparues.
‘Dans le cas du loup sinistre, ce n’est qu’un OGM de loup gris avec un certain nombre de modifications ponctuelles’, affirme-t-il. ‘Certes, c’est une prouesse technique, mais n’appelons pas cela une désextinction.’ Il précise qu’on peut surtout parler d’une chimère vivante, dont le génome a été légèrement modifié pour évoquer une espèce disparue.
Les auteurs présentent l’ouvrage comme un cadre pour aborder la question de l’extinction, tout en indiquant que les techniques envisagées pourraient, à terme, contribuer à lutter contre la perte de biodiversité, sans faire naître d’espoir démesuré.
Des enjeux économiques avant tout, selon les auteurs
Pour Cavin, l’enjeu économique est central et souvent sous-tendu par des gains estimés « en milliards ». Cette dynamique explique en partie le choix de reproduire des espèces emblématiques comme le mammouth, non pas pour résoudre l’effondrement de la biodiversité, mais pour attirer l’attention et certains financements.
Selon Alvarez, le véritable business model viserait plutôt une diversification des compétences en génétique afin d’alimenter d’autres secteurs, notamment l’agronomie et la médecine, plutôt que de ressusciter des espèces éteintes. « Le véritable business plan, c’est de se diversifier dans un maximum de secteurs pour occuper d’autres marchés », résume-t-il.
L’idée que la désextinction pourrait compenser la perte de biodiversité est jugée illusoire par les deux auteurs. Ils soulignent aussi que certains commentaires publics, comme ceux évoqués par des responsables politiques, peuvent être trompeurs quant à l’utilité réelle de ces recherches.
Derrière ces réflexions, la démonstration souligne surtout le rôle de la génétique et de ses applications possibles dans d’autres domaines, tout en rappelant la prudence nécessaire face à des promesses qui ne se réalisent pas immédiatement.